Une femme s’évanouit de manière théâtrale, un objet roule doucement au sol en gros plan, des inconnus fomentent un plan machiavélique juste à côté des concernés… Le cinéma est rempli de motifs, parfois récurrents, qui intriguent et s’impriment dans nos esprits. Le deuxième mardi de chaque mois, nous vous proposons le défi “Un bon film avec…” : chaque rédactrice dénichera un film en lien avec un thème (plus ou moins) absurde mais qui vient naturellement à l’esprit. Pourquoi ces images s’imposent-elles ? Quel sens recouvrent-t-elles dans notre imaginaire ? Et dans l’œuvre ? Les retrouve-t-on dans un genre précis ? Comment deviennent-elles des clichés ?
Ce mois-ci, nous nous intéressons aux arbres qui tombent. Catastrophe naturelle, dangereuse nature ou fait de l’homme, l’arbre qui chute est un motif redondant du cinéma, mais à plusieurs significations, que nous allons prendre plaisir à vous décortiquer.
Un des premiers thèmes qui nous vient à l’esprit est celui de la nature dangereuse, souvent exploitée dans les films catastrophes ou d’horreur. L’arbre chute au milieu d’une route, empêchant ainsi les victimes de fuir ou qui s’écrase sur la voiture au mauvais moment. L’arbre qui tombe et souvent accompagné d’une tempête. La nature devient violente et se dirige contre l’homme. Les catastrophes naturelles, ou invasion d’aliens sont également un bon moment pour l’arbre de tomber. En plus de la crevasse béante qui s’ouvre, la route barrée est présage de danger. L’arbre ici qui tombe est poussée par les forces de la nature, ce n’est pas la main de l’homme qui l’a coupé. Dans le film The Impossible de Juan Antonio Bayona, les arbres qui tombent au loin annoncent le tsunami qui arrive.
Dans d’autres films, c’est l’inverse qui se produit. C’est l’homme qui est contre la nature. Dans Princesse Mononoke (Mononoke-Hime) d’Hayao Miyazaki, l’homme est un envahisseur qui perturbe l’ordre des choses. Alors que les animaux étaient les garants et protecteurs de la forêt, les voici qu’ils se retournent contre elle comme possédés. Dans une scène, un sanglier est transformé en un monstre vorace qui détruit tout sur son passage. A la poursuite d’un soldat à cheval, il arrache arbres et plantes qui chutent dans un tourbillon. Dans Avatar de James Cameron, pour détruire et posséder une planète entière, les hommes n’hésitent pas à massacrer le peuple présent. La chute d’un arbre centenaire immense montre le moment fatal de la guerre sans mercis. Le film oppose un peuple qui vit dans le respect de la nature et l’homme qui sans cesse veut posséder plus. Ce qui est également le cas, dans Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours quand Saroumane coupe et brûle des milliers d’arbres et transforme son royaume en une terre désolée et sinistre, métaphore de l’industrialisation poussive de l’homme.
L’arbre peut représenter également un symbole : la vie. Dans L’Arbre de Julie Bertuccelli, Charlotte Gainsbourg, Dawn, perd son mari à la suite d’une crise cardiaque. Seule avec ses trois enfants, elle n’arrive pas à oublier. Sa plus jeune fille lui révèle que son père s’est réincarné dans l’arbre immense. Cela permet à Dawn de se reconstruire. Mais alors que les racines deviennent de plus en plus envahissantes, Dawn se retrouve devant un fois difficile, voire impossible : devoir abattre l’arbre. Ici, le problème de Dawn est que non seulement, l’arbre représente le mari défunt, mais également une renaissance, une jouissance nouvelle de la vie. Ce n’est pas un hasard si Terrence Malick à nommer son film : The Tree of Life par ailleurs.
Dans ce défi, nous vous parlons de Citizen Kane d’Orson Welles, Pompoko (Heisei tanuki gassen pompoko) d’Isao Takahata, Harry Potter et la Chambre des Secrets (Harry Potter and the Chamber of Secrets) de Chris Colombus.
Citizen Kane, Orson Welles, 1941
Charles Foster Kane vient de mourir. Ce magnat de la presse laisse un empire et un mystère. Un reporter part sur les traces de la signification du dernier mot qu’il a prononcé sur son lit de mort : Rosebud.
Le film d’Orson Welles — qu’il a produit, avec le studio de la RKO et la Mecury Production, réalisé, scénarisé et où il interprète le rôle principal — est un monument de l’histoire du cinéma. Quand il réalise son premier long-métrage à l’âge de 25 ans, avec toutes les cartes en mains, il y a bien là les éléments pour en faire une légende. Beaucoup diront que l’histoire de Citizen Kane est également tirée de sa propre vie. Le film rencontre, lors de sa sortie, un fort succès critique, mais pas public. Il faudra attendre quelques années, avant la reconnaissance de critiques comme André Bazin, à la fin des années 1950, pour que le film soit encensé. Il est aujourd’hui considéré comme une des oeuvres majeures du XXe siècle. Pendant plusieurs décennies, il est même cité comme meilleur film de tous les temps.
Citizen Kane regorge d’éléments, de motifs réutilisés dans de nombreux films : les titres de journaux qui s’accumule, la façon dont Charles meurt… Le mot Rosebud devient une référence dans le cinéma et beaucoup de films l’utiliseront — au cours de l’année écoulée nous avons par exemple Ready Player One et Chambre 212. Pourtant, pour ce défi nous nous attardons sur un élément qui pourrait passer inaperçu pendant le visionnage du film : l’arbre abattu. Ce moment, très bref, dure effectivement à peine 3 secondes et s’inscrit dans l’accumulation de ce qu’a possédé Charles Foster Kane avant de mourir.
Alors que le film s’ouvre sur Xanadu — demeure démesuré — et des plans lugubres, Kane meurt sur son lit. Avec des plans audacieux : filmé à travers une boule de neige, gros plans sur les lèvres, lumière en clair-obscures et musique funèbre, le début est marqué par une mise en scène baroque. Très vite, le récit nous explique que nous avons affaire à un magnat de la presse fraîchement décédé qui faisait dans l’exubérance et la surconsommation. Un reportage télévisé nous apprend tout ce qu’il faut savoir sur sa vie. Après un court résumé sur Xanadu et sa fabrication — il aura fallu quelque cent mille arbres pour sa construction — le journaliste nous énumère tout ce que Kane a accumulé pendant sa vie. Le premier plan montre une vieille bâtisse dans une ville animée : c’est là où il a commencé. Puis une carte avec tous les médias qu’il a achetés : journaux, syndicats, radio ; un empire médiatique puissant. Avec les ondes et les esprits, Kane possède aussi les estomacs avec un supermarché, mais également les habitations et la pierre : un immeuble. Des usines qui crachent des tonnes de nuages blancs dans l’air, un paquebot, qui coupe en deux la mer, représente une ligne marine et une mine d’or.
Entre les usines et la mer, le commentateur dit : « il achète une forêt ». L’image qui apparaît est celle d’un arbre qui chute violemment dans une rivière avec un homme en amont, les mains sur les hanches, qui semble satisfait. Il s’agit presque d’une image subliminale qui dure 3 secondes. Avec cet effet, d’accumulation, le cinéaste montre la mégalomanie de son personnage.
En moins de trois secondes, il résume la possession d’une forêt par un arbre abattu
Ici, cette courte séquence sous-entend que le meilleur moyen de posséder une forêt est dans la destruction. L’homme achète pour posséder entièrement. Ce à quoi se résume la vie du personnage : les femmes qu’il a aimées puis abandonnées ont été humiliées. Il a perdu son meilleur ami au profit de l’argent et du pouvoir. Le feuilleton dénonce, dans la suite d’images une surenchère : il a commencé dans un bâtiment délaissé, mais regardé tout ce qu’il a eu. De plus, le récit rajoute l’idée que l’on peut acheter la nature : il possède la mer, les sols avec l’or et la forêt. Ainsi, ce bref passage et cette image presque subliminale renvoient à un esprit profondément humain : tout s’achète. Mais comme le reste du film le montre bien, l’argent ne rend personne heureux, et encore moins l’abondance. Kane meurt seul, malgré son palais immense, son zoo personnel, ses gondoles, plus d’œuvres d’art qu’aucun musée ne pourrait avoir. Et il ne rendit personne heureux autour de lui. Cette accumulation et la destruction d’une forêt pour avoir un château ne sont finalement que le reflet de la mégalomanie humaine.
Ainsi, l’arbre est coupé par la main de l’homme. Pas de nature dangereuse, mais une nature qu’on achète et qu’on possède. Mais la destruction n’amène que la destruction et Xanadu, à la fin de la vie de Kane, n’est qu’un palais fantôme où la brume et la mélancolie ont élu domicile.
Marine Moutot
Citizen Kane
Réalisé par Orson Welles
Avec Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore
Drame, Biopic, Etats-Unis, 1h59, 1941
Sorti en juillet 1946 en France
Pompoko (Heisei tanuki gassen pompoko), Isao Takahata, 1996
A mesure que la population de Tokyo croît, la ville s’agrandit. Bientôt débute le chantier de création d’une ville nouvelle, au bord de la rivière Tama. Les tanuki, animaux de la mythologie japonaise, décident d’utiliser leur pouvoir de transformation pour combattre la destruction de leur habitat.
La forêt, grignotée par l’aire urbaine, est au coeur des préoccupations des tanuki, dont le film embrasse le point de vue. De nombreux plans de la nature en soulignent la beauté et l’atmosphère paisible. Les habitations sont enveloppées de multiples nuances de vert. Les inserts de bourgeons et de fruits puis les plans de la jeune famille tanuki, dans un style réaliste, magnifient des détails ordinaires et le rythme lent et régulier de la nature. Les chants d’oiseaux et de cigales ainsi que la mélodie au piano complètent ce paisible tableau.
Premiers plans d’une nature verdoyante et enveloppante
Inserts de détails réalistes
Représentation d’une famille tanuki dans un style réaliste
Ce décor est petit à petit grignoté par la ville. L’irruption de celle-ci est soudaine : dans le nid des tanuki, filmé de l’intérieur, surgit la bouche géante d’une pelleteuse crevant le plafond. La mise en scène la désigne immédiatement comme élément perturbateur : son bruit mécanique vient recouvrir tout autre son et, obligeant les tanuki à vivre au crépuscule et la nuit, elle semble faire perdre sa verdure à la forêt, qui est alors représentée dans des tons rouges et bleus. Cet élément nous fait découvrir les tanuki sous leur forme bipède et les incite à contre-attaquer.
Irruption d’un engin dans le champ
Plans au crépuscule et la nuit : la nature semble avoir perdu sa verdure
Première action d’envergure pour faire cesser le chantier : un raid en pleine tempête. Takahata utilise à nouveau des inserts pour caractériser le lieu de l’action. Il s’agit de plans aux tons gris, striés de pluie, parfois décadrés, d’éléments biscornus du chantier, contrastant de manière flagrante avec les premiers plans du film. La ville en construction semble être un lieu apocalyptique. La chute de l’arbre, qui nous intéresse, est rapide. Un premier plan, en contre-plongée, nous place du point de vue humain, pour qui l’événement est soudain et d’origine inconnue. Le camion chute et sort du plan. Retour aux tanuki, qui révèlent leur véritable forme : l’arbre, c’était eux, transformés en tronc. La sortie de champ du camion semble présager leur victoire. Comme pour le confirmer, le ciel se dévoile et redevient bleu. Cependant, le type d’attaque, l’arbre qui tombe, c’est-à-dire un arbre mort ou condamné, ainsi que son tronc qui se délite pour redevenir tanuki présagent en réalité leur échec. Faire tomber quelques camions ne sauvera pas la forêt…
Paysage gris, ambiance apocalyptique
La chute de l’arbre-Tanuki
Après l’attaque du chantier, le ciel se découvre
Ce raid éclair reflète la complexité et les contradictions des tanuki. Ils se transforment en arbre et en pierre, éléments naturels, mais également en pont, construction humaine. Comme leurs transformations qui varient, entre imitations de la nature et imitations des humains, ces animaux mythologiques oscillent entre Nature et Culture. La contre-attaque des tanuki est facilitée par les hamburgers McDonald, qui permettent de mener un conseil à bien, les boissons fortifiantes, qui permettent aux transformistes de garder forme humaine, la télévision, qui tient la population canine informée de la posture et des réactions des citadins, ainsi que les livres, qui donnent sa dernière idée d’attaque à Gonta, chef de la faction “rouge” des tanuki, qui prône l’attaque directe et meurtrière. C’est pourtant leur attachement à la nourriture humaine qui freine leur agressivité, comme lors du hold up raté de Gonta, où attaquants et otages rêvent ensemble des différentes manières de cuisiner une souris. Plus tôt déjà, sa véhémence avait été arrêtée par l’évocation de tous les mets auxquels les tanuki devraient renoncer s’ils tuaient tous les humains.
C’est que les tanukis sont ici un symbole. A travers eux, c’est de nous que Ghibli parle. L’habitat recréé à la fin du film, illusion qui vient recouvrir la ville nouvelle, n’est pas une forêt sauvage, mais un paysage de campagne qui émeut les humains autant que les tanuki. Une femme y aperçoit deux membres de sa famille et, visage transformé par l’émotion, courre vers eux. Pompoko a la nostalgie du temps passé et de ses traditions, un temps où les hommes vivaient paisiblement, en harmonie avec la nature et les créatures qui y séjournent.
Réaction émue d’une femme face à la recréation (illusoire) d’une scène d’antan
Les retrouvailles de la famille humaine soulignent l’importance des liens et de la convivialité, que la ville semble avoir perdus. La communauté est centrale chez les tanuki, qui passent de longues heures à débattre et festoyer. Les sages d’autres territoires n’hésitent pas à venir apporter leur aide à la population de Tama. La transformation en arbre et, plus tard, l’Opération Ectoplasmes, ne nécessitent-elles pas également que les Tanuki s’unissent afin de créer et soutenir l’illusion ? C’est aussi ce que rappelle la fin du film, avec les retrouvailles de Shokichi et de Ponkichi : tant que les tanuki peuvent être ensemble, manger et faire la fête, “ils continuent à traverser tous les obstacles” et “vivent dans la nonchalance et la gaieté”. La dernière chanson, qui ne fait pas mention des tanuki, semble s’adresser aux humains-spectateurs : “Il y aura toujours quelqu’un auprès de moi / (…) Il y aura sûrement, sûrement / Toujours quelqu’un avec moi / Même si ton village natal est bien loin désormais / N’oublies jamais le vent qui t’y berçait”
Finalement, les tanuki et leur art de la transformation évoquent le cinéma, lui aussi art de l’illusion qui permet de réunir les êtres et de réenchanter le monde. Tout comme les tanuki utilisent leur art pour changer les choses et appellent les spectateurs à lutter pour les lapins et les belettes, le cinéma peut être politique. Cependant, le constat de Takahata est amer : l’émerveillement provoqué par l’art de l’illusion est dévoyé à des fins mercantiles par un parc d’attraction et, si l’impact politique est réel, il reste minime. Le reportage TV a bien permis de garder des parcs à l’intérieur de la ville nouvelle (parcs dans lesquels les tanuki non transformistes peuvent se retrouver) mais pas la forêt, recouverte par la ville. En témoignent les derniers plans de verdure, tanuki courant dans les bois, déchets humains et panneaux de circulation au premier plan, et tracé géométrique d’un parc. La foi semble être placée en les enfants, principaux spectateurs émerveillés par les illusions des tanuki.
Les derniers bois de Tama
Surcadrages : la parade des spectres comme sur un écran de cinéma
Spectateurs émerveillés par les illusions des Tanuki
J. Benoist
Pompoko (Heisei tanuki gassen pompoko)
Réalisé par Isao Takahata
Amination, Aventure, Japon, 1h59
1996
Harry Potter et la Chambre des Secrets (Harry Potter and the Chamber of Secrets), Chris Colombus, 2002
En pleines vacances d’été chez son oncle et sa tante, Harry reçoit la visite d’un elfe de maison, Dobby, le prévenant qu’une grande menace Poudlard. Quelque temps après la rentrée des classes, Harry entend une voix lui murmurer que la dangereuse Chambre des Secrets a de nouveau été ouverte. Des étudiants sont retrouvés pétrifiés et le mystère s’épaissit. Harry et ses amis Ron et Hermione s’unissent pour venir à bout de ce fléau.
Dans l’enceinte de Poudlard pousse au milieu de la cour le fameux Saule Cogneur. Cet arbre enchanté d’une taille et d’une prestance étonnante effraie les élèves avec ses poings en guise de branches et sa souplesse au niveau du tronc. Ici il ne se tombe pas comme un arbre simple abattu : il a la capacité de se coucher et de se relever. Sa première apparition à l’écran se situe dans le deuxième volet, Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002). Après avoir raté le train qui les emmène à Poudlard, Ron et Harry emprunte la voiture du père Weasley pour rejoindre l’école. Leur périple mouvementé se termine dans les griffes du Saule Cogneur. La vieille voiture atterrit dans les branchages et se fait éjecter avec en prime quelques coups sur la carrosserie.
L’arbre est perçu comme un pur danger par les élèves dans cette première rencontre. Il possède une puissance dont on ne se méfie pas au premier abord, mais qui peut se révéler dévastatrice. À la moindre perturbation, le Saule Cogneur se réveille tel un animal. Il commence à grogner et déploie sa force instinctive : se débarrasser de toute autre forme de vie l’approchant de trop près, en l’occurrence la voiture avec Ron et Harry. Un clin d’oeil à la nature telle que nous la connaissons. Si l’ordre est déréglé, elle reprend alors ses droits sur l’homme. Contrairement aux étudiants, l’arbre est considéré comme un être à part entière et respecté par les professeurs de l’école. Planté il y a des années par Dumbledore, l’incident créé par Ron et Harry va générer une remarque plutôt étrange venant de Rogue. Le Saule Cogneur aurait « subi des dommages considérables » à cause des agissements inconscients des deux élèves. Une inquiétude qui échappe totalement à la nouvelle génération de sorcier qui ne voit que le danger face aux forces de cette nature magique.
Or cette magie n’a pas été créée comme simple élément de décoration. Le Saule Cogneur se révèle être un gardien essentiel de l’équilibre de Poudlard. On apprendra dans le troisième film de la saga que l’arbre a été conçu comme porte vers la cabane hurlante se situant aux abords de l’école, le refuge de Remus Lupin lors des soirs de pleine Lune où il se transforme en loup. L’arbre est une frontière naturelle, il protège l’homme des dangers que le monde recèle. Dans ce monde magique où il est parfois attaqué, l’arbre plie mais ne rompt jamais.
Ron et Harry tente d’échapper aux poings du Saule Cogneur
Clémence Letort-Lipszyc
Harry Potter et la Chambre des Secrets (Harry Potter and the Chamber of Secrets)
Réalisé par Chris Colombus
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Fantastique, Royaume-Uni, Etats-Unis, 2h30
Sortie le 4 décembre 2002
Retrouvez nos prochaines pépites le mardi 10 septembre 2019. Nous vous proposerons plusieurs bons films avec une scène dans une salle de cinéma.
Vous aussi, mettez-nous au défi de dénicher des films en rapport avec votre thème, en votant pour le Défi #5 avant le 9 septembre 2019. Vous pouvez également proposer de nouveaux thèmes en commentaire ou sur les réseaux sociaux.























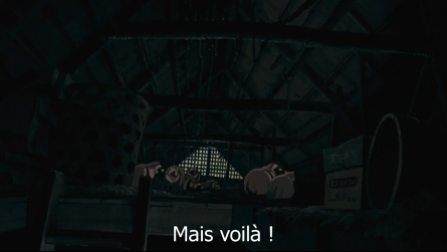
































4 commentaires sur « [DÉFI] Un bon film dans lequel un arbre tombe »